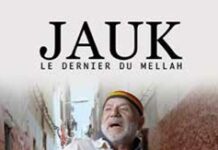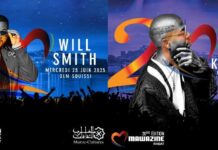Bien qu’elle soit une réalité historique qui n’a nullement besoin d’être prouvée, la Souveraineté du Maroc sur son Sahara a nécessité un travail de longue haleine, juridiquement parlant, afin qu’elle soit admise à l’échelle internationale.
Les Marocains se souviennent du 16 octobre 1975 non seulement comme du jour de l’annonce de la Marche verte, mais aussi comme de la date à laquelle la Cour Internationale de Justice (CIJ) a rendu son Avis consultatif sur le cadre juridique du Sahara.
Le Jour où la vérité a éclaté
Le même jour, feu Sa Majesté Hassan II prononça un discours analysant l’Avis de la CIJ, tant sur la forme que sur le fond. Le défunt Souverain constata tout d’abord que la Cour avait accepté un avis reconnaissant l’existence d’un différend juridique entre l’Espagne et le Maroc, et avait donc autorisé un juge ivoirien à représenter le Maroc. Hassan II poursuivit en déclarant que la Cour Internationale de Justice avait affirmé que le Sahara n’était pas une terra nullius (terre sans maître) lorsqu’elle a été occupée par l’Espagne et qu’elle avait également reconnu les liens juridiques régis par le Serment d’Allégeance (La Baia) entre les populations Sahraouies et les Sultans marocains.
Feu Hassan II développa les raisons de la non-affirmation de Souveraineté par la Cour, expliquant que le concept de la Baiâa dans l’histoire marocaine, revêt un caractère unique, car elle a toujours été écrite. Le Royaume est en effet, le seul pays à ne jamais s’être fondé uniquement sur une Allégeance orale, mais a toujours exigé un serment écrit, entre le Peuple et le Trône.
Sur cette base, le Défunt Souverain, proclama la Marche Verte afin de recouvrer les Provinces Sahariennes du Maroc non pas par la violence ou les armes, mais à travers un mouvement humain inégalé dans l’histoire et qui s’est distingué par son caractère pacifique.
Pourquoi avoir porté le Dossier du Sahara devant la CIJ?
Avant de répondre à cette question, il faut rappeler qu’avant sa libération en 1975, le Sahara était occupé par l’Espagne depuis 1884. Lorsque le gouvernement de Franco y a voulu organiser un référendum en 1974, à la suite d’un pseudo recensement conçu pour servir les intérêts coloniaux dans cette Région du Maroc, le Royaume a conjointement avec la Mauritanie, cherché à saisir la Cour internationale de Justice (CIJ). Ce recours à la CIJ fut initié par le Roi Hassan II, qui a annoncé lors d’une conférence de presse le 17 septembre 1974 l’intention de Rabat de soumettre son différend avec l’Espagne devant ladite Cour.
Rabat a initialement proposé que le dossier soit soumis conjointement avec Madrid à la CIJ pour un avis consultatif sur le statut du Sahara et sur la question de savoir s’il s’agissait d’un territoire inhabité à l’arrivée de l’Espagne en 1884. Cependant, la partie espagnole a interprété cette démarche comme une reconnaissance d’un différend juridique entre elle et le Maroc, ce qui contredisait sa propre approche de la gestion de la question du Sahara, à l’époque. En conséquence, Madrid rejeta la demande marocaine. Le Royaume présenta alors sa proposition à l’Algérie et à la Mauritanie. La Mauritanie l’accepta, tandis que l’Algérie refusa d’y participer, arguant qu’elle ne possédait aucune revendication territoriale au Sahara, ce que les faits démentiront au cours des années et décennies suivantes.
Au final, la demande d’avis de la CIJ concernant le statut juridique des Provinces Sahariennes du Royaume sera soumise par le Maroc et la Mauritanie. Sur la base de cette demande conjointe, l’Assemblée Générale des Nations-Unies adoptera le 13 décembre 1974, une Résolution saisissant la Cour Internationale de Justice du différend saharien. Cette Résolution qui a recueilli 80 voix pour, 43 abstentions et aucune voix contre, a été officiellement déposée auprès de la Cour le 21 décembre 1974.
Pour saisir l’importance de l’Avis favorable au Maroc rendu par la CIJ le 16 octobre 1975, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière. Tout d’abord, cet Avis fait partie d’un long processus que le Maroc a entamé dans le cadre de la volonté de libérer l’ensemble de son territoire national, sachant que même après s’être affranchi de la colonisation française en 1956, plusieurs terres marocaines étaient encore occupées (Tarfaya, Sidi Ifni, Tanger, Provinces Sahariennes).
Face à cette situation, Rabat a choisi la voie du droit international pour faire valoir ses droits. D’ailleurs, le Maroc a été élu au Comité des six par l’Assemblée Générale des Nations-Unies en 1959 et a activement participé à la création d’un comité spécialisé sur les territoires non autonomes, entre autres. Cela montre clairement la forte présence du Maroc au sein des Institutions et des travaux des Nations-Unies, défendant aussi bien son Intégrité Territoriale, que les questions du Continent africain et arabe. A ce propos, il convient de rappeler que le Maroc a été parmi les premiers à défendre le droit de l’Algérie à son indépendance, bien qu’elle le lui ait mal rendu.
S’appuyant sur les principes-mêmes de la Résolution 1541 des Nations-Unies promulguée le 15 décembre 1960, le Royaume a toujours défendu l’idée que l’application des principes d’autodétermination et de décolonisation n’entraîne pas nécessairement et automatiquement la création d’un Etat indépendant, et que chaque cas de décolonisation présente des caractéristiques propres, outre le fait que la bonne application des résolutions de l’ONU consiste à concilier les principes de décolonisation avec le respect de l’Intégrité Territoriale des Etats Souverains.
Depuis son indépendance en 1956, le Maroc a toujours affirmé son droit à la Souveraineté sur son Sahara. Dans le Discours qu’il a prononcé, le 25 février 1958 à M’hamid El Ghizlane, devant plusieurs tribus sahraouies venues prêter Allégeance au Trône Alaouite, Feu Sa Majesté Mohammed V affirma que le Maroc ne ménagera aucun effort et déploiera tous les moyens nécessaires pour recouvrer ses Provinces Sahariennes.
Historiquement, l’autorité sur le Sahara est restée entre les mains des différentes Dynasties qui ont Régné sur le Royaume. Juridiquement, plusieurs décrets administratifs, religieux et spirituels nommant des juges et des chefs de tribus sahraouies, promulgués par les Sultans marocains, attestent de leur loyauté envers le Pouvoir central. Socialement et économiquement parlant, les habitants des Provinces Sahariennes du Royaume se sont intégrés à ceux des autres Régions du pays, adoptant la même culture et les mêmes traditions. Le commerce s’est également développé pendant plusieurs siècles entre les Provinces du sud et les différentes régions du pays.
Les Nations-Unies à travers notamment son Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, les Comités Spéciaux et la 4ème Commission, sont témoins de l’origine du conflit autour du Sahara et de la volonté de certaines parties, à leur tête l’Algérie, de faire perdurer ce faux problème, ad vitam aeternam. Cette volonté d’instrumentaliser cette affaire perdure encore aujourd’hui, mais se désagrège de jour en jour, surtout depuis que le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté une nouvelle Résolution (2797), le 31 octobre 2025, dans laquelle il consacre le caractère exclusif du Plan marocain d’Autonomie de 2007, comme cadre unique pour parvenir à une solution définitive à ce Dossier.