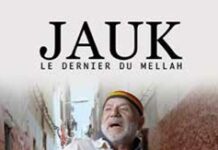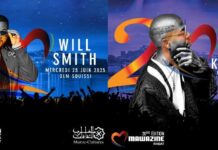Les travaux de la cinquième édition du Forum MD Sahara se sont poursuivis samedi 15 novembre 2025. Pour cette deuxième et dernière journée, les organisateurs avaient prévu un programme dense fait de conférences et de débats thématiques.
Il est 9 heures 30 lorsque les participants prennent place dans la grande Salle du Palais des Congrès à Dakhla. Les interventions s’annoncent riches, les échanges promettent d’être animés, le tout dans une atmosphère empreinte de gravité et d’attention.
L’ouverture est assurée par Omar Hilale, Ambassadeur-Représentant Permanent du Maroc auprès des Nations-Unies, dont la voix et la présence imposante installent d’emblée le ton de la journée. Son intervention, centrée sur le thème: «La Diplomatie Marocaine au Service de la Paix, de la Stabilité et de la Coopération Africaine», résonne comme un témoignage et une analyse profonde. Visiblement ému, le diplomate n’a pas caché l’importance de ce moment. «Nous venons de vivre un moment historique dans la vie de notre Nation», déclare-t-il en évoquant l’Adoption de la Résolution 2797 du 31 octobre 2025 du Conseil de Sécurité, qui consacre l’Initiative marocaine d’Autonomie comme base du processus politique autour du Sahara. Mais il nuance aussitôt, expliquant que malgré cette victoire, il reste encore du travail à faire. «Le plus difficile est devant nous, dans la mesure où il faut convaincre les autres parties qu’il n’y a pas d’autres solutions que l’Autonomie pour clore définitivement le Dossier du Sahara».
L’Ambassadeur du Maroc à l’ONU développe ensuite un plaidoyer dense en faveur de la Diplomatie Royale en Afrique, qu’il qualifie de «trajectoire d’exception». Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dit-il, la diplomatie marocaine s’est affirmée comme une diplomatie d’action fondée sur des principes constants et des initiatives concrètes.
Les Piliers de la Diplomatie Royale
En structurant son intervention autour des trois piliers de la Charte des Nations-Unies (Développement, Droits de l’Homme, Paix et Sécurité) Omar Hilale met en lumière la Vision Royale d’un Continent confiant en ses propres forces et moyens. «L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique», rappelle-t-il, citant les propos du Souverain à Abidjan en 2014. Pour lui, cette conviction s’est matérialisée à travers plus de 1.000 accords et trente visites Royales dans le Continent.
Plusieurs initiatives emblématiques incarnent cette orientation, parmi lesquelles le Gazoduc Nigeria-Maroc, l’Initiative Royale visant à offrir aux pays du Sahel un accès stratégique à l’Atlantique, ou encore la stratégie Triple A dédiée à l’adaptation de l’agriculture africaine. «Ces projets traduisent la solidarité, la sécurité énergétique et la souveraineté alimentaire», souligne-t-il, y voyant une vision d’intégration africaine articulée autour de la coopération et de la durabilité. Il évoque aussi la diplomatie bleue du Maroc. «Il ne suffit pas de parler pour l’Afrique, il faut permettre à l’Afrique de parler d’une seule voix», dit-il, en référence au travail de convergence mené par le Maroc avant la Conférence de Nice sur les océans.
Sur la question des droits de l’Homme, O. Hilale insiste sur l’harmonie entre les principes et l’action. Il rappelle que la Constitution de 2011 a fait des droits humains une «nécessité stratégique». A cet égard, il met en avant la politique migratoire humaniste lancée en 2013, sous les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a rompu avec une logique strictement sécuritaire au profit d’une approche inclusive. Plus de 50.000 migrants africains ont été régularisés, tandis que l’Observatoire africain de la migration, inauguré à Rabat en 2018, a institutionnalisé cette vision.
Le Diplomate cite également les initiatives marocaines à l’ONU, comme la Résolution établissant le 18 juin comme Journée internationale de lutte contre le Discours de haine. Pour lui, ces actions traduisent une diplomatie spirituelle et culturelle au service de la dignité humaine.
Concernant le pilier de la paix et de la sécurité, il rappelle que le Maroc adopte une vision globale de la sécurité. «Comment parler de sécurité à celui qui ne mange pas à sa faim? Comment promettre la stabilité à celui que la sécheresse chasse de ses terres?», s’interroge O. Hilale.
Le Maroc fut parmi les premiers pays africains à envoyer des Casques bleus en République démocratique du Congo dès 1960, et cet engagement, à tous les niveaux, n’a jamais diminué, rappelle le Diplomate marocain, en rappelant que la Conférence internationale d’investissement en faveur de la République centrafricaine, organisée à Casablanca à la demande du Président Faustin Touadéra, a permis de mobiliser 9 milliards de dollars.
Omar Hilale décrit la Diplomatie Royale comme un modèle de constance et de transformation «fondé sur la confiance plutôt que la méfiance, la coopération plutôt que l’isolement, la dignité humaine plutôt que la domination». Et d’Ajouter que «la diplomatie marocaine ne pavoise pas sur les acquis, mais construit l’avenir, tend la main, anticipe et façonne les événements». Pour conclure, O. Hilale rend hommage à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a fait du Maroc une voix africaine crédible et écoutée dans le concert des Nations.
Défis du Sahel et solidarité africaine
Le Maroc parle et l’Afrique lui répond. Mamadou Tangara, ancien ministre des Affaires Etrangères de Gambie et actuel Chef de Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel, intervient avec un ton profondément fraternel.
Son intervention, consacrée au thème: «L’Afrique Face aux Défis du Sahel, Diplomatie, Sécurité et Solidarité», prend des airs de témoignage vécu. Il décrit la montée du terrorisme, l’effondrement de certains Etats, les déplacements massifs de populations et la fragilité des économies. Sans dramatiser ni minimiser, il montre que ces défis ne peuvent être relevés qu’à travers un Continent solidaire.
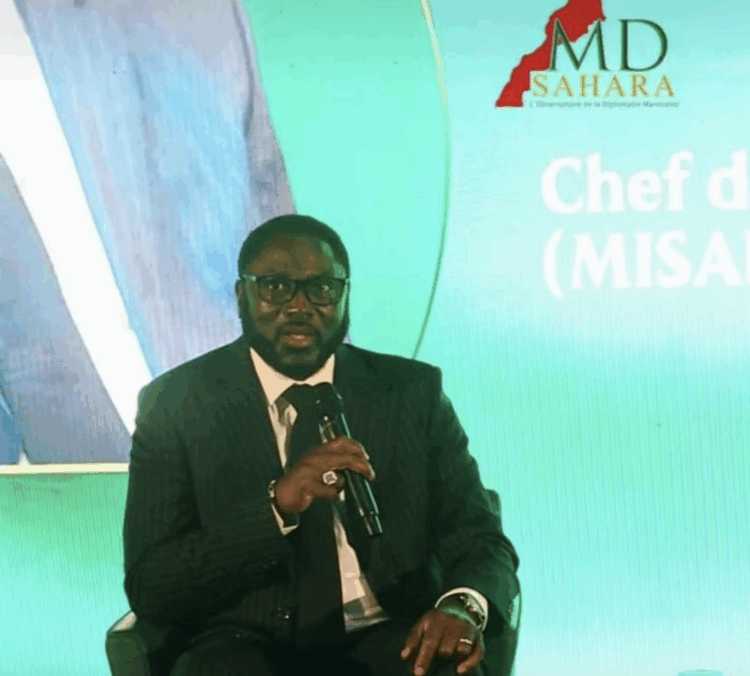
Avant de développer sa réflexion, il tient à saluer la Diplomatie marocaine, rendant hommage à «l’excellent travail du ministre Nasser Bourita et de son équipe». Il qualifie aussi l’Ambassadeur Hilale comme «l’un des plus grands diplomates aux Nations-Unies, très respecté». Il raconte une anecdote où O. Hilale, attaqué violemment lors d’une réunion, a «démonté les arguments de son adversaire». Une scène révélatrice d’une diplomatie solide, rigoureuse et sûre d’elle.
Sur la question du Sahara, Mamadou Tangara est on ne peut plus franc et direct. «Nous reconnaissons pleinement la Marocanité du Sahara», dit-il, avant de rappeler que la Gambie fut le premier pays à ouvrir un Consulat à Dakhla, ouvrant la voie à d’autres nations.
Mais c’est sur le Sahel que son discours prend toute sa force. Selon lui, le problème majeur est «l’incapacité de certains à comprendre la réalité du terrain et la tentation d’imposer des solutions». On ne peut pas, dit-il, venir avec des «lunettes occidentales». Il cite un proverbe nigérian: «On a beau aimer la personne, on ne peut pas lui faire une belle coupe en son absence». Autrement dit, aucune solution ne peut s’imposer sans les populations concernées. C’est là que l’approche marocaine se distingue.
«SM le Roi Mohammed VI a compris très tôt, qu’il fallait avant tout écouter les principaux concernés», explique Mamadou Tangara. En recevant les ministres des Affaires Etrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le Maroc a instauré un climat de confiance, souligne le responsable gambien. Alors qu’ils étaient «pratiquement isolés» après leur suspension de la Cedeao et de l’Union Africaine, Rabat a en effet maintenu le dialogue avec ces pays. Ce n’est pas tout. Comme l’a si bien rappelé M. Tangara, au plus fort de l’épidémie d’Ebola, alors que presque toutes les Compagnies aériennes au niveau international avaient suspendu leurs vols, Royal Air Maroc a continué d’opérer vers les pays précités.
Pour Mamadou Tangara, la pauvreté constitue le principal terreau du terrorisme. En soutenant les institutions, en formant des cadres, en maintenant les liens économiques, le Maroc contribue à stabiliser la Région. L’Initiative Royale visant à donner aux pays du Sahel un accès à l’Atlantique représente, dit-il, une «opportunité historique» pour désenclaver leurs économies et créer un «espace de prospérité».
Son plaidoyer se conclut sur un avertissement. «Si un de ces pays tombe, toute la zone du Sahel sera déstabilisée. Personne ne sera à l’abri». Il souligne à cet égard que «le Maroc est une ancre de stabilité, un partenaire fiable et un médiateur crédible».
Le Sahara, moteur et modèle de développement
A partir de 11 heures, les discussions prennent une dimension économique avec la Keynote de Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). Son intervention qui s’articulait autour du thème: «Investir pour transformer, la vision de la CDG pour un développement territorial équilibré», a rappelé que la stabilité politique ne peut durer sans équilibre territorial (voir la suite du dossier).
De 10h30 à 11h45, une table ronde consacrée au thème «Investir dans le Sahara, vers un modèle économique durable et inclusif» a réuni 6 personnalités clés, chacune éclairant à sa manière la transformation du Sahara marocain.
Ali Seddiki, Directeur Général de l’AMDIE, a ouvert les échanges en expliquant que Dakhla n’est pas une ville émergente mais déjà un hub international, s’appuyant sur des données chiffrées concernant l’afflux d’investissements nationaux et étrangers, ainsi que sur les projets industriels émergents dans les Provinces Sahariennes.
Nisrine Iouzzi, chargée de l’aménagement du Port Dakhla Atlantique, a décrit ensuite l’envergure d’un chantier qui redessinera les routes commerciales du Continent. Elle a mis l’accent, entre autres, sur la connectivité maritime, l’économie bleue et la projection logistique du Maroc vers l’Afrique australe.
Abdellah Mouttaqi, Vice-Président Exécutif de la Compagnie Minière Touissit (CMT), et Lhou Maacha, Directeur Exécutif d’Exploration du Groupe «Managem», ont élargi la réflexion au secteur minier. Ils ont ainsi évoqué la hausse de la demande mondiale en minerais critiques, l’importance d’une souveraineté industrielle africaine et la capacité du Maroc à devenir une plateforme minière régionale.
Enfin, Ahmed Kathir, Directeur du Centre Régional d’Investissement Dakhla–Oued Eddahab, a rappelé que cette dynamique n’est pas seulement économique mais aussi démographique et humaine. Il évoque l’urbanisation, la formation, l’entrepreneuriat local et l’élévation des compétences dans les Provinces du Sud. «La croissance au Sahara marocain profite pleinement à ses habitants», affirme-t-il.
La Session suivante, de 11h50 à 12h45, a exploré la dimension symbolique, historique et politique. Autour du thème «Regards Croisés sur la Marche Verte», quatre intervenants offrent une profondeur nouvelle aux discussions.
Christian Cambon, Sénateur français et Président du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc, a salué la continuité du partenariat Maroc–France en Afrique et souligne la stabilité du Royaume. Luis Filipe Tavares, ancien ministre des Affaires Etrangères du Cap Vert a présenté l’Afrique Atlantique comme un espace d’opportunités où le Maroc joue un rôle moteur.
Jean-Yves de Cara, Grand Juriste français, a pour sa part, apporté une perspective académique en démontrant les bases juridiques solides de la Marocanité du Sahara.
Quant à Henri Vedie, économiste, il a expliqué comment l’héritage de la Marche Verte est devenu un modèle économique durable grâce aux infrastructures, aux ports, aux zones logistiques et aux politiques publiques. Cette session rappelle que le Sahara n’est pas un acquis figé mais un projet en constante évolution.
Vers 12h50, le dernier panel de la matinée a abordé la question du Sahara sous l’angle du leadership national et de la diplomatie d’influence. Les interventions d’Aïcha Duihi, Gajmoula Bousif, Ilyan Berradi et Houyam Benhammou ont donné à la salle une énergie nouvelle. Voix civiles, féminines, jeunes et engagées, elles ont insisté sur une idée forte, que la Marche Verte qui a soufflé cette année sa 50ème bougie (6 novembre 1975-6 novembre 2025), n’est pas un souvenir mais un héritage vivant, porté par une jeunesse consciente de sa responsabilité dans le Maroc d’aujourd’hui et de demain.
Lorsque la pause déjeuner est annoncée, un sentiment domine dans le Palais des Congrès de Dakhla, celui d’avoir vécu une matinée mêlant stratégie diplomatique, ambition économique, profondeur historique et engagement citoyen. Le Sahara marocain apparaît alors comme un espace où le Royaume construit non seulement son avenir mais contribue également à l’édification d’un Continent qui croit en ces capacités de développement et en le savoir-faire de ses enfants. Le meilleur exemple en la matière est ce Méga Projet en cours de construction au cœur des Provinces Sahariennes du Royaume. Baptisé Port Dakhla Atlantique, cette infrastructure portuaire située à une quarantaine de kilomètres de Dakhla, vise à renforcer les échanges à attirer de nouveaux investissements et à créer des milliers d’emplois. Il s’agit également de relier l’Europe, l’Afrique et les Amériques en servant de plateforme logistique stratégique.
Pour constater de visu l’état d’avancement des travaux de construction dudit Port, les organisateurs du Forum MD Sahara 2025 ont invité la presse et les participants à ce Congrès, à une visite sur place.
DNES à Dakhla: Mohcine Lourhzal
Photos: Soufiane Benkhadra